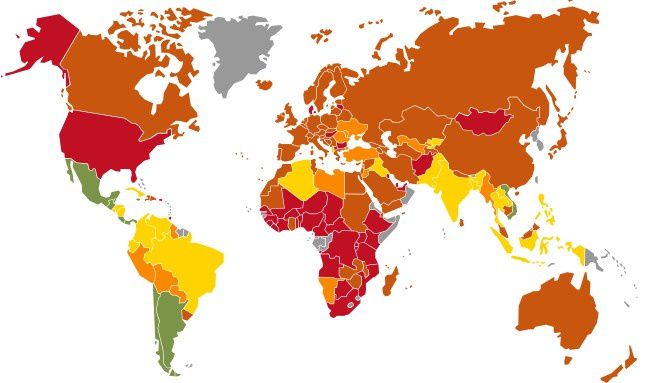À propos de la méta-analyse de Baranski (Leifert) et al.
Les zélateurs du « bio » ont eu leur jour de liesse le 11 juillet 2014. Enfin surtout dans le monde anglophone, la France ayant sombré dans la léthargie estivale. Ce jour là, M. Carlo Leifert, de l'Université de Newcastle, a annoncé la publication de « Higher antioxidant concentrations and less cadmium and pesticide residues in organically-grown crops: a systematic literature review and meta-analyses » (des concentrations plus élevées d'antioxydants et moins de cadmium et de pesticides dans les produits de l'agriculture biologique : un examen systématique de la littérature et méta-analyses) dans le British Journal of Nutrition [1].
À lui seul, le titre est un résumé de l'article sous la forme d'un slogan et un cri de victoire.
La communication est aussi péremptoire : la preuve a été faite de la supériorité nutritionnelle et de santé de la filière chère à M. Leifert, et de ses chers (aux deux sens du terme...) produits. Qu'en est-il vraiment ?
QUELQUES RAPPELS
Des allégations de supériorité du « bio » infondées, sinon mensongères
Interdites par le droit dans le cadre commercial...
Faisons un détour par le droit.
« 2. Aucune allégation ne peut être faite dans l'étiquetage ou la publicité suggérant à l'acheteur que l'indication figurant à l'annexe V constitue une garantie d'une qualité organoleptique, nutritionelle ou sanitaire supérieure. »
C'est ce que disait l'article 10 du Règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires [2].
Le législateur avait à l'époque pris une sage décision : empêcher que la promotion du « bio » ne se fasse au travers de la mise en accusation du « conventionnel ».
Cette disposition ne figure plus dans le texte actuellement applicable à l'agriculture biologique (Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 [3].
Mais le Règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires s'y est substitué à toutes fins utiles [4]. Son article 3 interdit notamment les allégations nutritionnelles et de santé susceptibles de : «susciter des doutes quant à la sécurité et/ou à l'adéquation nutritionnelle d'autres denrées alimentaires ».
...elles foisonnent dans les médias...
Mais si elles sont interdites dans le cadre commercial, ces allégations sont monnaie courante dans les médias. Ce que le législateur a pu instaurer pour les acteurs économiques, il ne pouvait à l'évidence pas l'imposer à d'autres, au mépris de la liberté d'expression. D'aucuns ont exploité le filon.
Les allégations de supériorité des produits bios sont explicites ou implicites, notamment par le biais d'insinuations de dangers contre les produits de l'agriculture conventionnelle. Elles ont fortement imprégné les esprits – grâce aussi, disons-le, à l'indifférence et au manque de vigilance des milieux de l'agriculture qui nous nourrit. Si la filière « bio » se montre dans l'ensemble mesurée, en France tout au moins, les thuriféraires et zélateurs du « bio », les vendeurs de pilules miracles et de sirops de jouvence, et les charlatans de la diététique se livrent à un véritable dénigrement de l'agriculture conventionnelle sur les aspects de la santé et de l'environnement.
...et même dans la législation et la communication gouvernementale !
Ce n'est pas comparatif, mais la comparaison est implicite dans le considérant 1 du Règlement n° 834/2007 dont les allégations sont en partie reprises à l'article 3 :
« La production biologique est un système global de gestion agricole et de production alimentaire qui allie les meilleures pratiques environnementales, un haut degré de biodiversité, la préservation des ressources naturelles, l'application de normes élevées en matière de bien-être animal et une méthode de production respectant la préférence de certains consommateurs à l'égard de produits obtenus grâce à des substances et à des procédés naturels. Le mode de production biologique joue ainsi un double rôle sociétal: d'une part, il approvisionne un marché spécifique répondant à la demande de produits biologiques émanant des consommateurs et, d'autre part, il fournit des biens publics contribuant à la protection de l'environnement et du bien-être animal ainsi qu'au développement rural. » [3]
Sur le site du Ministère de l'agriculture consacré au mode de production biologique :
« L’agriculture biologique (AB) est un des 5 signes officiels d’identification de la qualité et de l’origine. Elle garantit une qualité attachée à un mode de production respectueux de l’environnement et du bien-être animal. » [5]
Quelles impostures. L'agriculture biologique, c'est le respect d'un cahier des charges. Point.
Le difficile rôle de la science
Les produits de l'agriculture X sont-ils meilleurs sur le plan nutritionnel et de la santé (et aussi organoleptique) que les produits de l'agriculture Y ? Inéquation difficilement soluble pour la science !
Les raisons factuelles
L'agriculture biologique a une définition juridique qui prévoit un cahier des charges essentiellement constitué d'interdictions (pas de fertilisants ni de produits phytosanitaires de synthèse, pas d'OGM, pas d'hydroponie, etc.), impose seulement une obligation de moyens, mais permet des modes de production et des itinéraires variés. L'agriculture conventionnelle est, par défaut, celle qui n'est pas biologique. Les deux modes se chevauchent. On peut ainsi pratiquer une agriculture biologique intensive, ou suivre le cahier des charges de l'agriculture biologique sans être certifié, et donc sans avoir droit à la mention « bio ». Il existe dans les deux dénominations des itinéraires techniques et des niveaux d'intensification différents, se répercutant sur les qualités organoleptiques et nutritionnelles des produits.
Les raisons politiques et idéologiques
En France, le Grenelle I de l'environnement fixait, en 2007, comme objectif national 6 % de la surface agricole utile en 2012 et 20 % en 2020 en agriculture biologique. On est devenu plus réaliste entre-temps pour les surfaces, mais au profit d'un très fumeux « projet agro-écologique » [6].
L'Europe s'est aussi mise sur le mode biologique au début des années 2000. Elle a adopté en 2004 un plan d'action en vue de le développer [7]. L'action 7 avait consisté à renforcer la recherche, avec deux conséquences, une spécifique, une générale.
La spécifique est que M. Leifert – notre auteur principal – et l'Université de Newcastle ont emporté un appel d'offres et se sont retrouvés à la tête d'un projet, Quality Low Input Food (QLIF) (aliments de qualité à bas intrants), sur lequel nous reviendrons ci-dessous [8].
La générale est que se sont développées les recherches dirigées vers un objectif, en particulier celui de démontrer l'intérêt du mode de production biologique. La pression sociétale – politique et idéologique – définit donc explicitement ou implicitement les axes de recherche, les résultats attendus et la manière de les présenter. Les financements, la notoriété, l'avancement dans la carrière, etc. dépendent du « politiquement correct ». Il faut donc donner une image favorable des formes d'agriculture se distinguant de celle qui est vilipendée, dénigrée par le qualificatif « productiviste » (alors qu'elle nous nourrit...). Et c'est sans compter le formatage intellectuel des générations montantes...
Ce biais dans la recherche se traduit aussi, par conséquent, par un biais de publication.
Cette situation a de profondes ramifications. Ainsi, dans le domaine des OGM soumis aux mêmes contraintes, cela contribue au silence pesant qui règne, en France notamment, sur les mycotoxines chez le maïs, sachant qu'en parler revient inévitablement à devoir exposer à un moment ou un autre les avantages des plantes Bt, mieux protégées des contaminations que les plantes classiques.
La vraie science, celle qui se fonde sur le rationalisme, est aussi concurrencée par la science « parallèle », celle qui, au service d'une idéologie ou d'une filière économique, pose une conclusion a priori, en fonction d'un préconçu, et s'emploie ensuite à la « démontrer ».
Les questions de valeur relative des agricultures se traitent dans des milieux variés : de l'institut de recherche prestigieux et généraliste à l'obscure officine de promotion de l'agriculture biologique, en passant par l'institut plus ou moins prestigieux abritant une équipe contaminée par l'idéologie.
Trier le bon grain de l'ivraie est donc une véritable gageure.
Les raisons pratiques
Ces questions sont aussi traitées de différentes manières. On peut notamment comparer entre eux :
- des produits collectés sur les étals, mais on n'aura eu aucun contrôle sur les conditions de culture ;
- des produits issus d'exploitations voisines comparables, mais il restera des différences et des incertitudes ;
- des produits issus d'un essai contrôlé, mais l'homogénéisation des conditions de culture conduit à des écarts avec la réalité du monde agricole [9].
Les biais expérimentaux
On peut penser que les scientifiques maîtrisent suffisamment bien les biais de collecte de données (par exemple, les tomates ont-elles toutes été récoltées au même stade de maturité ?). Quoique...
Que comparent les chercheurs dans leurs essais en conditions contrôlées ? Il y a des chances que se soit l'agriculture biologique idéale et idéalisée, et l'agriculture conventionnelle au mieux banale, au pire caricaturale.
Ce problème se pose, dans le cadre de cet article, tout particulièrement pour la teneur en cadmium des produits, pour laquelle la méta-analyse trouve un impressionnant et étonnant avantage à l'agriculture biologique. Le cadmium provient dans une assez large mesure des engrais phosphatés. Or l'agriculture biologique n'autorise que les phosphates naturels, plutôt riches en cadmium ; et elle est plutôt laxiste en la matière (la limite est de 90 mg/kg de P205). Mais les expérimentations sont généralement conduites sur des cultures qui n'auront reçu que des engrais organiques...
À côté de cela il existe de nombreux pièges. Citons en trois, tirés d'un excellent article de M. Joseph D. Rosen, « A Review of the Nutrition Claims Made by Proponents of Organic Food » (une revue des allégations nutritionnelles faites par les promoteurs de l'agriculture biologique) [10] :
- Il existe une abondante littérature sur l'influence, très importante, du climat sur le sens des différences de composition que l'on constate entre produits biologiques et conventionnels. D'une année à l'autre, les différences peuvent changer de sens. On peut donc affirmer avec une certaine mesquinerie que, pour avoir le « bon » résultat, il suffit de répéter l'essai jusqu'à tomber sur la « bonne » année. Cet effet année est bien connu des amateurs de vins.
- Une équipe de l'Université de Californie a trouvé dans des kiwis issus de l'agriculture biologique une plus grande teneur en vitamine C et composés phénoliques. En fait, ceux-ci sont concentrés dans la peau, qui était plus épaisse sur ces kiwis. Mais la peau n'étant pas consommée, la différence n'avait donc pas de réelle signification nutritionnelle... ce qui n'empêche pas la publication de se retrouver dans des méta-analyses...
- Une équipe japonaise a comparé cinq paires de légumes-feuilles, ceux issus de l'agriculture biologique ayant été produits par utilisation de chitosan comme stimulant des défenses naturelles. Les importantes différences constatées pour certains composés ne sont pas dues au mode de production, mais à l'effet du chitosan.
L'interprétation des résultats
L'étape de l'interprétation des résultats est aussi confrontée à des défis considérables :
- Un résultat sur la tomate, par exemple, est-il généralisable à l'ensemble des légumes, voire des denrées alimentaires ?
- Comment combiner des résultats obtenus pour un même facteur sur plusieurs espèces cultivées pour former une image synthétique pour une catégorie de produits (les légumes par exemple), voire l'ensemble des produits ?
- Comment combiner des résultats obtenus pour plusieurs facteurs sur une même espèce pour former une image synthétique ?
- Et, évidemment, comment combiner les résultats obtenus sur plusieurs facteurs pour plusieurs espèces.
En résumé, le domaine est soumis à d'importants biais d'interprétation. On trouve de tout dans la littérature, la divergence des résultats et des conclusions étant en partie inévitable et en partie (mais dans quelle proportion ?) le fruit de démarches idéologiques.
Les incertitudes sous-jacentes
Et il y a une autre difficulté encore !
Constater qu'un produit issu du mode de production X contient plus d'un composé défini, ou moins, permet-il réellement de conclure à la supériorité de ce mode ? Ceci se décompose en deux questions : sommes-nous sûrs de l'effet nutritionnel et de santé du composé ? Et l'augmentation ou la diminution constatée de la teneur a-t-elle une signification nutritionnelle et de santé ?
La méta-analyse, une solution ?
Qu'est-ce ?
Confronté à une littérature divergente, comment se former une opinion ? La méta-analyse est une démarche de combinaison des résultats d'une série d'études indépendantes – au sens premier, et non postmoderne, d'indépendantes les unes des autres – pour en tirer une image globale ; en tirer des tendances, identifier les convergences et différences et leurs causes, et tout autre élément d'appréciation qui aurait échappé dans les études individuelles. Elle fait largement appel à la statistique, contrairement à l'analyse qualitative.
La version anglaise de Wikipedia [11] fournit des explications détaillées. La version française est d'une indigence crasse... reflet du problème sérieux d'acculturation scientifique de la société française. Même la version galicienne est plus détaillée...
Les difficultés et les écueils
La méta-analyse est sans conteste un outil d'acquisition de connaissances. Il faut toutefois être conscient de ses limites :
- Elle utilise un fond documentaire existant et, sauf à les identifier et les corriger, subit les biais de publication, dont l'« effet tiroir » (les chercheurs et les revues scientifiques publient davantage sur les expériences ayant obtenu un résultat positif, les expériences soutenant l'hypothèse nulle ou n'atteignant pas le seuil de signification restant « au fond du tiroir »).
- Elle subit aussi le risque de « garbage in, garbage out » : les publications de mauvaise qualité peuvent difficilement mener à une analyse de qualité.
- La première étape de la méta-analyse consiste à sélectionner des publications. Même si cela se fait sur des critères objectifs, il y a un risque de biais de sélection, d'origine humaine (subjectivité ou, pire, motivation cachée, mais aussi... langue !) ou induit par les critères eux-mêmes (dans le domaine de l'agriculture, par exemple, ne retenir que les articles publiés dans des revues à comité de lecture revient à écarter la plupart de celles issues des services de vulgarisation).
- Elle peut agréger des résultats de travaux issus de méthodes différentes (le « problème des pommes et des poires »).
- Elle peut aussi inclure des études qui semblent indépendantes mais reposent en réalité sur le même ensemble de données, leur conférant un poids supérieur à celui qu'elles méritent.
Un peu d'histoire : à hue et à dia !
On trouve de tout dans la littérature ! Nous n'aborderons ici que quelques études emblématiques pour planter le décor. Un décor important car la méta-analyse Leifert et al. est manifestement une sorte de réponse du berger à la bergère. Annonçons la couleur : à Dangour et al.
Shane Heaton, pour la Soil Association, 2001
La Soil Association est l'entité qui promeut l'agriculture biologique au Royaume-Uni. L'étude « Organic farming, food quality and human health : a review of the evidence » (agriculture biologique, qualité des aliments et santé humaine : le point), est clairement une œuvre de commande [12].
Sir John Krebs, président de la Food Standards Agency (FSA – agence des normes alimentaires) avait en effet déclaré en août 2000 :
« Il n'y a pas aujourd'hui suffisamment d'informations pour nous permettre de dire que les produits bio sont significativement différents en termes de sécurité et de contenu nutritionnel des produits issus de l'agriculture conventionnelle. »
Il fallait donc que le résultat de l'étude réponde aux attentes du commanditaire... Pour les besoins de cette étude, l'auteur, un nutritionniste indépendant, a exclu 70 publications sur 99, au motif notamment que l'histoire des sols n'était pas connue.
L'étude prétend donc tirer sa crédibilité de sa sélectivité, alors que Leifert et al. se sont prévalus du grand nombre d'études retenues... Autres temps, autres mœurs ; ou autres moyens pour arriver aux fins.
Cette étude est intéressante par le ton fort mesuré des résultats et des recommandations. Mais nous sommes en 2001... quoique nous fussions dans la période de la vache folle, les peurs alimentaires et la technophobie n'avaient pas encore atteint la dimension ni l'impact sur la production scientifique qu'elles ont aujourd'hui. S'agissant des nutriments secondaires, il est ainsi écrit :
« La recherche commence à confirmer l'attente que l'on a des productions biologiques, à savoir qu'elles contiennent une plus grande variété et une plus grande quantité de substances naturelles autrefois connues comme métabolites végétaux secondaires ou phytonutriments. »
Et pour la première recommandation :
« Les consommateurs souhaitant améliorer leur consommation de minéraux, de vitamine C et de phytonutriments antioxydants tout en réduisant leur exposition à des résidus de pesticides potentiellement néfastes, aux nitrates, aux OGM et aux additifs artificiels utilisés dans l'industrie agroalimentaire devraient, à chaque fois que possible, choisir des aliments issus de l'agriculture biologique. »
Mais il y avait la publication et... la communication. Le Guardian a ainsi rapporté ce propos de M. Heaton, pour lequel il n'y a aucune base dans l'étude [13] :
« Les chiffres officiels montrent un déclin alarmant des niveaux de minéraux dans les fruits et légumes au cours du demi-siècle passé. »
L'indigence journalistique, le double langage de la Soil Association et les déficiences de l'étude ont fait l'objet d'une critique cinglante qui vaut d'être lue [14].
Toujours est-il que la FSA a annoncé dès la publication de l'étude qu'elle allait commander une nouvelle étude. La guerre des études britanniques a commencé...
AFSSA, 2003
Détour par la France. L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA, maintenant ANSES) a produit une analyse qualitative en avril 2003, « Évaluation des risques et bénéfices nutritionnels et sanitaires des aliments issus de l’agriculture biologique » [15]. C'est une expertise couvrant un très large éventail de questions. S'agissant des « phytomicroconstituants », elle conclut :
« Par ailleurs, même s’il existe une augmentation des teneurs, comme c’est le cas pour les composés phénoliques, il n’a pas encore été démontré que cela se traduisait par une plus grande biodisponibilité et donc un effet plus protecteur. De plus, le bénéfice santé lié à la consommation plus importante de phytomicroconstituants observé dans quelques études épidémiologiques demande à être confirmé. »
Le site charlatans.info a produit un résumé de l'étude [16]. On peut aussi consulter un article publié en 2009, dans Innovations Agronomiques, par M. Denis Lairon, de l'INSERM, qui fut le président du groupe de travail de l'AFSSA et que l'on peut classer parmi les « pro-bio » [17].
Cette analyse de l'AFSSA est aussi intéressante par un morceau d'anthologie, figurant dans l'introduction, sur les difficultés auxquelles s'est heurtée l'étude :
« 3 – La troisième difficulté tient à la crainte, exprimée à de multiples reprises par les professionnels de l’agriculture biologique, qu’un rapport de cette nature puisse susciter des inquiétudes parmi les consommateurs, dès lors qu’il était évoqué des problématiques de maîtrise sanitaire, ou de vulnérabilité sur le plan sanitaire de certaines pratiques ou bien que des constats fondés sur les seules données scientifiques sous-estiment des effets positifs de l’agriculture biologique qui ne seraient pas objectivables par les études disponibles. »
Il faut que la science confirme le dogme...
Zombie (Carlo Leifert), 2007)
Fin octobre 2007, les médias britanniques ainsi que, évidemment, les sites biophiles bruissent à la nouvelle que les produits biologiques seraient plus sains [18]. Le conditionnel est de rigueur : c'était une annonce ne reposant sur aucune publication scientifique.
Pour une raison que nous n'avons pas pu déterminer, M. Carlo Leifert, à l'époque coordonnateur du projet Quality Low Input Food (QLIF) (aliments de qualité à bas intrants) [8], a cru bon de communiquer. Rappel, peut-être nécessaire à ce stade d'une si longue introduction : M. Leifert est l'auteur principal de la méta-analyse qui fait l'objet du présent billet.
Ce programme d'une durée de cinq ans (de 2004 à 2009), s'inscrivant dans le Sixième programme-cadre pour la recherche et le développement technologique, a été financé par l'Union européenne à hauteur de 12,4 millions d'euros pour un budget total de 18 millions. Il y a un résumé des résultats daté d'avril 2009 [19]. Son sous-titre est éloquent : « Advancing organic and low-input food » (promouvoir les produits de l'agriculture biologique et de celle à bas niveau d'intrants). Pour le domaine qui nous intéresse ici, une des conclusions est :
« Les allégations de santé pour les produits de l'agriculture biologique ne sont pas encore prouvées. »
Notons que le site Organic World tenu par le FiBL (Institut de recherche de l'agriculture biologique, suisse avec des antennes en Allemagne et en Autriche – partie prenante du projet QLIF) ne fait pas état de cette conclusion [20]... Quand un fait dérange, on le passe sous silence dans ce monde...
Pourtant – revenons à octobre 2007 – M. Leifert clame que, selon les résultats préliminaires du programme QLIF, les fruits et légumes issus de l'agriculture biologique contiennent 40 % de plus d'antioxydants que les contreparties conventionnelles. S'aventurant dans le domaine nutritionnel, il déclare aussi :
« Si vous avez tout juste 20 % de plus d'antioxydants dans chaque portion de légumes, alors c'est tout simplement une question de maths – manger quatre portions de fruits et légumes biologiques équivaut à manger cinq portions de fruits et légumes traditionnels. »
Comme si les bienfaits des fruits et légumes se concentraient exclusivement dans les antioxydants !
En conséquence, la Food Standards Agency britannique devait selon lui modifier ses recommandations sur les produits de l'agriculture biologique ; il s'étonna même qu'elle ne l'eût pas encore fait...
« Je me demande s'il n'y a pas des motifs politiques. »
La Soil Association met aussi la FSA en demeure. Il lui faut :
« ...admettre et reconnaître publiquement les bénéfices nutritionnels des aliments produits selon des systèmes bien conduits d'agriculture biologique ».
Un autre site, Angrymoms, reproduit un article paru dans le Sunday of London. Les maths de M. Leifert sur les portions de fruits et légumes s'adressent à une population plus ciblée : les enfants et leurs mères [21] :
« Si vous avez juste 20 % de plus d'antioxydants et que vous ne pouvez en donner cinq par jour, alors vous pourrez être du bon côté avec quatre. »
Même les services de l'Union européenne chargés de la recherche (CORDIS) se sont excités sur cette annonce [22]. Mais personne n'a assuré le suivi et vérifié si l'annonce n'était pas de l'esbroufe.
Et, avec le passage du temps, l'annonce devient encore plus tonitruante. Les produits bio seraient même 300 % meilleurs que les conventionnels [23] !
Charles (Chuck) Benbrook et al., 2008
À l'époque conseiller scientifique de l'Organic Center états-unien, M. Charles Benbrook a publié en mars 2008, avec quatre co-auteurs, un document au titre explicite, « New Evidence Confirms the Nutritional Superiority of Plant-Based Organic Foods » (de nouvelles preuves confirment la supériorité des aliments d'origine végétale issus de l'agriculture biologique) [24].
C'est clairement un document de promotion de l'agriculture biologique, conformément à la mission implicite de l'Organic Center, mais il est remarquablement bien fait. Les institutions de recherche « traditionnelles », ainsi que l'industrie, devraient du reste s'interroger sur les moyens qu'ils mettent en œuvre pour faire leur propre effort de vulgarisation.
Les auteurs sont partis de la littérature peer-reviewed publiée après 1980 et ont retenu 97 études fournissant 236 comparaisons bio-conventionnel scientifiquement valides. Ils précisent qu'ils estiment que leur méthode de tri a rempli son rôle de sélection des données de la plus haute qualité mais reconnaissent – avec honnêteté – qu'il y a d'autres méthodes pour atteindre cet objectif de qualité.
Ils exposent aussi les difficultés des comparaisons, ainsi que les écueils, mettant leurs résultats en perspective (même si cela ne transparaît pas forcément dans le résumé et les recommandations). L'information est donnée, et ce, dans des parties opportunément intitulées, par exemple, « key caveats » (mises en garde essentielles) et « methodological issues in comparing nutrient levels in organic and conventional foods » (problèmes méthodologiques des comparaisons de niveaux de nutriments dans les aliments bios et conventionnels).
S'agissant des polyphénols et des antioxydants, ils ont trouvé que les trois quarts environ des 59 échantillons bios en contenaient davantage que les échantillons conventionnels. Ils ajoutent dans le résumé :
« Augmenter l'ingestion de ces nutriments est un objectif vital pour l'amélioration de la santé publique car les doses journalières ingérées d'antioxydants et de polyphénols sont inférieures de plus de la moitié aux doses recommandées. »
Cette conclusion est-elle recevable sur la base des résultats ? On se fera son jugement à partir des tableaux 5.3 et 5.4 du document sur l'amplitude des différences en faveur du bio ou du conventionnel, respectivement (au fait, pourquoi deux tableaux ?).
Sur les 44 résultats en faveur du bio pour le total des composés phénoliques, le pouvoir antioxydant total, la quercétine et le kaempferol – des résultats peut-être liés en partie –, la moitié se trouve sous la barre des 20 % de différence. Selon le tableau 5.6, les différences moyennes s'étagent de 1,05 (soit 5 %) à 1,24, la quercétine émargeant à un facteur 2,40 (grâce à une étude biaisée du fait de l'utilisation du chitosan – voir ci-dessus).
Ce document a bien sûr produit une avalanche d'articles encenseurs d'une presse béate et niaise, ainsi que des nombreux sites et blogs favorables à l'agriculture et l'alimentation biologiques. Les critiques sont difficiles à trouver. Est-ce parce que la vraie science n'y a pas prêté attention ? Il est vrai que le document de l'Organic Center n'a pas été publié dans une revue scientifique à comité de lecture... Ou est-ce parce que l'altermonde est expert pour faire apparaître ses productions en tête des résultats de recherche sur la toile ?
M. Rosen a produit deux critiques [25] [26]. En 2010, il écrivait :
« Et, tout comme la Soil Association [Shane Heaton], l'Organic Center a ignoré les résultats qui lui déplaisaient. » [10]
Alan Dangour et al., 2009
Une méta-analyse qui a laissé une trace durable – eh oui, elle est en anglais... – est celle de Dangour et al., « Nutritional quality of organic foods: a systematic review » (qualité nutritionnelle des aliments issus de l'agriculture biologique : une revue systématique), publiée en 2009 dans The American Journal of Clinical Nutrition [27]. C'est le résumé d'une étude plus détaillée établie par une équipe de la London School of Hygiene & Tropical Medicine pour le compte de la Food Standards Agency (FSA) [28]. Partant de 52.471 articles publiés après 1957 (en anglais ou avec un résumé en anglais...), les auteurs ont identifié 162 études, dont 55 de qualité satisfaisante, toutes postérieures à 1990. Ils ont étudié onze paramètres.
« Conclusions : Sur la base de l'examen systématique des études de qualité satisfaisante, il n'y a pas de preuves d'une différence dans la qualité nutritionnelle entre les denrées alimentaires produites par la voie biologique ou la voie conventionnelle. Les petites différences détectées sont biologiquement plausibles et se rapportent dans la plupart des cas à des différences dans les méthodes de production. »
Cette étude a évidemment suscité l'ire des promoteurs (pas tous...) et des adeptes du bio. M. Dangour a essuyé une bordée d'insultes [29].
M. Peter Melchett, directeur des politiques de la Soil Association, a dit [30] :
« Je suis en colère et déconcerté. Nous nous attendions vraiment à ce que la FSA rapporte des faits. [...] Je pense que ceci est scandaleux. »
Et prédit [29] :
« Il est dans la nature de la science que la mauvaise science ne dure pas et je suis convaincu que c'est de la mauvaise science. »
M. Charles Benbrook a accusé la FSA de « minimiser les résultats positifs en faveur des produits biologiques » en utilisant des données « de très vieilles études » et en omettant les mesures de « quelques nutriments importants » [30].
« Diet and Nutrition: Next Course in Organic Debate » (régime alimentaire et nutrition : le prochain plat du débat sur les produits biologiques) fait le lien entre cette étude et celle de Benbrook et al. [31]. Curieusement, M. David C. Holzman rapporte que Benbrook et al. avaient trouvé 80 % de plus de pouvoir antioxydant sur les produits bios (c'est 24 % dans la publication – le comité de rédaction a été attentif...).
Selon cet article, M. Benbrook reproche aussi à l'étude Dangour de ne pas avoir exigé que les variétés soient les mêmes dans les comparaisons et que les sols aient été cultivés en biologique pendant un certain nombre d'années. Sur le premier point, la réponse de M. Dangour n'est pas convaincante : « En général, je me rappelle, la plupart des études comparaient les mêmes variétés. »
M. Lairon a critiqué cette étude dans un communiqué publié sur le site du Comité interne en agriculture biologique de l'INRA [32]. Curieux procédé, qui assure la quasi-confidentialité des critiques, alors que M. Benbrook a produit, en plus de ses commentaires dans la presse, une lettre à l'éditeur [33].
M. Lairon reproche principalement à l'article dans AJCN de ne pas refléter correctement l'étude, ce qui revient essentiellement à contester les critères de sélection des sources de données :
« Avec une telle variabilité (espèces, teneurs) et un nombre aussi limité d’études, la probabilité de mettre en évidence des différences globales entre produits bio et conventionnels était extrêmement faible, et en effet l’article publié dans Am J Clin Nutr sur les seules 55 études conclu à une absence de différence à quelques détails mineurs près, pour les produits végétaux ou animaux. C’est cela, et seulement cela, dont a fait état la presse. »
Il note aussi :
« Le tableau de synthèse sur l’évaluation des données obtenues à partir des 162 études initialement sélectionnées montre pour les produits végétaux (Tableau 2, page 19), des teneurs supérieures en composés phénoliques et flavonols (anti-oxidants), en magnésium, en zinc, et en matière sèche et moins d’azote dans les produits bio. [...] Ces données sont en fait très comparables à celles de notre rapport de l’AFSSA, dans lequel, par une méthodologie d’évaluation différente, nous observions des tendances à plus de matière sèche, de magnésium et de fer dans les produits végétaux bio [...]. »
Il est difficile de juger : le document détaillé ne contient pas d'indication chiffrée sur l'ampleur des différences. Mais les différences que M. Lairon met en avant sont tirées de l'ensemble des études, et, sauf pour l'azote, le phosphore et l'acidité titrable ne se retrouvent pas dans les études de bonne qualité.
Ce commentaire de M. Lairon est aussi intéressant par le dérapage final vers un discours politique fortement chargé d'idéologie et d'émotionnel, mais on laissera le lecteur le découvrir.
On trouve une digression similaire dans une autre lettre à l'éditeur, de M. Donald L. Gibbon [34]. M. Dangour a répondu sans ambages : son étude est le fruit d'une commande, à laquelle il s'est tenu [35].
Alan Dangour et al., 2010
L'équipe Dangour a produit une nouvelle étude en 2010, également publiée dans The American Journal of Clinical Nutrition [36]. « Nutrition-related health effects of organic foods: a systematic review » (effets sur la santé liés à la nutrition des aliments issus de l'agriculture biologique) est aussi un résumé d'un document plus détaillé [37].
Elle repose sur 12 études (huit portant sur des études sur l'humain, dont six essais cliniques, une étude de cohorte et une étude transversale) et quatre études sur des lignées de cellules animales et humaines. Elle aboutit à la même conclusion : pas de supériorité du bio.
Crystal Smith-Spangler et al., 2012
L'étude Dangour a montré qu'il ne faisait pas bon s'attaquer à une idéologie et, il faut le dire, à des intérêts économiques bien organisés et médiatiquement puissants. Trouver une absence de preuve de supériorité de l'agriculture biologique est déjà un blasphème. « Are Organic Foods Safer or Healthier Than Conventional Alternatives?: A Systematic Review » (les aliments issus de l'agriculture biologique sont-ils plus sûrs et nutritionnellement meilleurs que leur contrepartie conventionnelle ? Une revue systématique) a subi un meilleur sort.
Cette étude de Smith-Spangler et al. a été publiée en septembre 2012 dans les Annals of Internal Medicine [38]. Conclusion tirée de 17 études sur des humains et 223 sur les teneurs en nutriments et contaminants de denrées alimentaires :
« La littérature publiée manque de preuve forte que les aliments issus de l'agriculture biologique sont significativement plus nutritifs que les aliments conventionnels. La consommation d'aliments issus de l'agriculture biologique peut réduire l'exposition aux résidus de pesticides et aux bactéries résistantes à des antibiotiques. »
Conclusion mesurée...
Le jour même de la publication, M. Benbrook, passé entre-temps au Center for Sustaining Agriculture and Natural Ressources de l'Université de l'État de Washington, publie des « réflexions préliminaires » [39]. L'étude est évidemment biaisée à son goût. Mais peut-être faut-il extraire ceci :
« Pour la plupart des gens, se tourner simplement vers des fruits et légumes, ou des produits laitiers ou de la viande, issus de l'agriculture biologique, ne devrait pas, en l'absence d'autres changements dans les choix et le régime alimentaires, produire des améliorations cliniquement significatives de leur santé [...]. »
Ne serait-ce pas se tirer une balle dans le pied ?
En fait, de nombreux commentateurs se sont attachés à extraire de l'étude les points en faveur de l'agriculture biologique, notamment sur la question de l'exposition aux pesticides. Ainsi M. Tom Philpott de Mother Jones [40]. L'Organic Trade Association va même jusqu'à titrer : « Stanford research confirms health benefits driving consumers to organic » (la recherche de Stanford confirme les bénéfices de santé menant les consommateurs vers le bio) [41].
La différence de traitement des études Dangour et Smith-Spangler est plutôt remarquable. On peut penser que c'est parce que le monde favorable au bio aux États-Unis d'Amérique a pu trouver des arguments en sa faveur et qu'il a estimé que ses intérêts n'étaient pas le mieux servis par une controverse. L'étude Dangour s'inscrivait en revanche dans le contexte d'une controverse acerbe au Royaume-Uni.
INRA, 2013
Que penser de la situation en France ?
Il faut terminer ce panorama fort incomplet par l'étude « Vers des agricultures à hautes performances » entreprise par l'Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), sous la direction de M. Hervé Guyomard, pour le Commissariat général à la stratégie et à la prospective et publiée en septembre 2013 [42]. Son volume 1 analysait les performances de l’agriculture biologique.
Il est impossible de résumer cette expertise collective d'une très grande minutie. Sauf à dire... qu'elle a déplu à un bonne centaine de chercheurs qui ont trouvé que la description de l'agriculture biologique n'était pas suffisamment favorable à celle-ci et qui, par conséquent, ont réclamé par une lettre du 20 décembre 2013... le retrait du document [43].
Au lieu de renvoyer les signataires à leurs paillasses ou à leurs études, la direction de l'INRA a préféré – peut-être sous la pression politique – engager le dialogue, par une lettre du 10 janvier 2014, accompagnée tout de même d'une réponse circonstanciée en cinquante pages [44].
Cela s'est passé en toute discrétion. Puis quelqu'un a estimé utile ou nécessaire de vendre la mèche. Il n'est pas anodin que le cirque médiatique ait été orchestré – en février 2014 – par l'intermédiaire de Reporterre.
Mais le plus important est ailleurs : 128 scientifiques – dont des directeurs de recherche et des professeurs – ont estimé que si la science n'était pas à leur convenance, il fallait la supprimer !
LA MÉTA-ANALYSE
Les auteurs
Une équipe issue du programme QLIF et une étude précontrainte
Dix-huit auteurs pour une méta-analyse ? C'est que cette publication est en quelque sorte une œuvre posthume du projet Quality Low Input Food (QLIF) [8], que nous avons déjà rencontré dans la première partie. Un programme dans lequel l'Union européenne a mis 12,4 millions d'euros et qui avait conclu à ceci en avril 2009 [19] :
« Les allégations de santé pour les produits de l'agriculture biologique ne sont pas encore prouvées. »
Le rapport final résumé est bien plus positif dans la base de données du Service Communautaire d'Information sur la Recherche et le Développement (CORDIS), et ce, malgré une absence patente de littérature citée à l'appui des allégations s'agissant des productions végétales [45]. C'est du lourd :
« Les résultats ont montré que les méthodes biologiques de production alimentaire se traduisaient par :
a) des niveaux plus élevés de composés désirables sur le plan nutritionnel (par exemple vitamines/antioxydants et acides gras polyinsaturés tels que oméga-3 et acide linoléique conjugué) ;
b) des niveaux moindres de composés indésirables sur le plan nutritionnel tels que les métaux lourds, les mycotoxines, les résidus de pesticides et les glycoalcaloïdes dans une série d'espèces ou le lait ;
c) un risque moindre de rejet de salmonelles fécales chez le porc.
Ces bénéfices nutritionnels ont été liés à des pratiques agronomiques particulières qui sont prescrites par les normes de l'agriculture biologique. Des études pilotes ont montré que ces différences de composition peuvent se traduire par des bénéfices de santé mesurables dans un système modèle expérimental avec des rats. Des études futures sont nécessaires pour en savoir davantage sur les interactions complexes entre les modes de production et les bénéfices pour la santé. »
À croire qu'il existe, en matière d'information scientifique, un canal A, pour les scientifiques, et un canal B, pour les politiques et les bureaucrates bruxellois...
Le programme s'était conclu par un congrès tenu à Antalya (Turquie) du 22 au 25 avril 2009. Le site dédié se limite maintenant à une page du comité d'organisation appelant à discuter du congrès dont les documents... ont disparu de la toile [46] !
Mais il reste une évaluation en marge :
« Cette conférence restera marquée dans l'histoire comme aidant le monde à éviter des atteintes personnelles sérieuses causées par l'alimentation, les normes industrielles, la supervision gouvernementale, et la fierté du corps, de l'esprit et de l'âme » (traduction littérale car c'est du charabia).
Ce n'est certes pas là l'analyse des auteurs de la méta-analyse... mais tout de même...
La méta-analyse est donc une œuvre étonnante, puisqu'elle apporte en 2014 les preuves (alléguées) qui manquaient en 2009, malgré les efforts déployés dans le cadre du programme... Elle est aussi le fruit d'une contrainte : pas question de se déjuger !
Des auteurs très engagés...
L'altermonde et les tenants des sciences « parallèles » sont friands des « conflits d'intérêts ». Bien évidemment si – et seulement si – la publication ne leur convient pas : l'auteur – ou un seul auteur, cela suffit – a ou est supposé avoir des liens d'intérêt avec la méchante industrie... et la publication est irrémédiablement mise au pilori.
Il convient de se pencher sur les liens d'intérêt des auteurs de la méta-analyse, ne serait-ce que pour leur rendre la pareille, sans pour autant succomber au délire de l'autodafé, car la valeur d'une publication s'estime sur la base de la seule publication. Mais ce qui est motif de rejet catégorique pour eux sera pour nous une alerte rouge.
M. Carlo Leifert. – M. Leifert, l'auteur principal de la méta-analyse que nous avons déjà rencontré dans la première partie, et coordinateur du projet QLIF, annonce en fin d'article qu'il possède des terres agricoles, exploitées conventionnellement, en Allemagne et une petite ferme, exploitée en bio, en Grèce. Cette information – qui n'a pas été donnée dans d'autres articles – peut être considérée comme de la provocation.
M. Leifert est en fait professeur d'« agriculture écologique » et dirige le Nafferton Ecological Farming Group [47]. Qu'est-ce que l'agriculture écologique [48] ?
« C'est une agriculture en harmonie avec la nature, qui utilise des techniques et des programmes de sélection [breeding] qui ne reposent pas sur des engrais chimiques solubles, des pesticides ou des herbicides, ou des modifications génétiques artificielles » (on peut aussi lire, hommage aux ambiguïtés permises par la langue anglaise et à l'incurie des auteurs : « ...des engrais, pesticides ou herbicides chimiques solubles » – sachant qu'en fait, « pesticide » est au singulier dans le texte original).
Être payé pour professer selon cette ligne philosophique, n'est-ce pas constitutif d'un conflit d'intérêts ?
De 1999 à 2009 (ce qui couvre le projet QLIF...), M.Leifert a été consultant pour TESCO, le plus grand vendeur de produits bio du Royaume-Uni. Ça doit être aussi grave que le fait que M. Richard Goodman, celui par qui les malheurs de M. Séralini sont paraît-il arrivés, ait été un employé de Monsanto neuf ans avant de devenir éditeur associé de Food & Chemical Toxicology. Il a aussi présenté des exposés devant la Soil Association, l'entité britannique qui fait la promotion de l'agriculture biologique. Ça doit être aussi grave que le fait que M. Goodman en ait présenté devant l'ILSI, cette association invariablement présentée comme un lobby...
L'information est difficile à trouver, mais l'« agriculture écologique » à la mode de l'Université de Newcastle doit beaucoup à TESCO, qui y a installé M. Leifert comme professeur et créé un Tesco Centre for Organic Agriculture dont l'adresse est à... Nafferton Farm et dont le directeur est... M. Leifert [10] [49].
Cette fonction est-elle moins importante que la propriété de terres agricoles ?
M. Leifert a aussi des opinions bien arrêtées sur les OGM. Il est un des premiers signataires de la « déclaration » de l'ENSSER – signée à ce jour par rien moins que 297 scientifiques (ayant ou non des compétences dans le domaine) et « scientifiques » (comme une certaine Vandana Shiva) – selon laquelle il n'y a pas consensus sur la sécurité des OGM [50].
Il a également signé la pétition de soutien à M. Séralini « End science censorship » et la lettre ouverte de Independent Science News [51].
Il s'est aussi associé à des activistes notoires – dont M. John Fagan et Mme Claire Robinson – pour produire « Roundup and birth defects – Is the public being kept in the dark? » (Roundup et malformations congénitales – le public est-il maintenu dans le noir) pour le compte d'Earth Open Source en vue d'influencer la réévaluation du glyphosate [52].
N'y a-t-il pas là manifestation d'une opinion susceptible d'influencer les travaux menés dans le domaine qui nous intéresse ?
M. Charles Benbrook. – Nous avons déjà rencontré M. Benbrook dans la première partie en tant qu'auteur d'une étude de la littérature concluant à la supériorité des produits de l'agriculture biologique et en tant que critique de méta-analyses ne concluant pas à cette supériorité. De 2004 à 2012, il fut conseiller scientifique de l'Organic Center – une entité chargée de la promotion de l'agriculture biologique aux États-Unis d'Amérique, sous le couvert d'une mission d'information scientifique qui ne trompe guère. Depuis août 2012, il est professeur-chercheur (« research professor ») au Center for Sustaining Agriculture and Natural Ressources de l'Université de l'État de Washington.
Selon la grille de lecture de l'altermonde et des tenants des sciences « parallèles », M. Benbrook est affligé d'un biais en faveur de l'agriculture biologique de nature à le disqualifier pour une méta-analyse sur ce sujet. « Aucune autorisation de plante GM tolérant un herbicide ne devrait être accordée en Europe » a-t-il par exemple écrit en octobre 2012 dans une œuvre de commande pour Greenpeace, prédisant une augmentation de... 800 % de l'utilisation du glyphosate à l'horizon 2025 si on autorisait le maïs, la betterave sucrière et le soja HT [53].
M. Benbrook n'a pas été impliqué dans le projet QLIF d'après le rapport final [45]. Il apparaît toutefois dans un papier non publié de Leifert et al. [54]. Onze auteurs de dix institutions différentes pour une courte revue de la littérature ! Nous sommes dans un système dans lequel on chasse en meute...
M. Urs Niggli. – M. Niggli est le directeur du FiBL, l'Institut de recherche de l'agriculture biologique suisse. À ce titre, il est payé pour faire la promotion de l'agriculture biologique (et biodynamique). C'est aussi un des grands noms de l'agriculture biologique dans le monde.
M. Niggli a aussi été le coordinateur académique du projet QLIF [19].
...et d'autres qui le sont moins, ou pas du tout
Il serait fastidieux d'éplucher les CV de tous les auteurs et de cribler les sites témoignant d'intérêts particuliers, voire de partis pris. Mais voici tout de même deux exemples d'auteurs qui .
Mme Ewa Rembiałkowska. – Professeure à la Faculté de nutrition humaine et de sciences de la consommation de l'Université des sciences de la vie de Varsovie, Mme Rembiałkowska est très impliquée dans le monde de l'agriculture biologique [55].
Mais elle a (co-)signé au moins deux publications plutôt mesurées sur les bénéfices nutritionnels et de santé des produits de l'agriculture biologique [56].
Elle a signé la déclaration de l'ENSSER [50].
M. Philippe Nicot. – M.Nicot est chercheur à l'unité de pathologie végétale INRA d'Avignon, son axe de recherche portant notamment sur le développement de solutions de biocontrôle et de stratégies de protection intégrée. C'est – apparemment – à ce titre qu'il évolue dans les milieux de l'agriculture biologique, sans y être exclusivement. Il est en particulier le secrétaire du conseil d'administration du GRAB, le Groupe de Recherche en Agriculture Biologique. Il est aussi président de la section ouest paléarctique de l'Organisation Internationale de Lutte Biologique et Intégrée (OILB), laquelle n'est inféodée à aucun système de production [57].
...alors, sont-ils « indépendants » ?
Chacun se fera son opinion !
Toutefois, la liste des publications consultées et, le cas échéant, retenues pour la méta-analyse montre que les auteurs ont été plutôt sélectifs à leur propre égard (par exemple trois publications seulement de M. Leifert) [58]. Cela témoigne d'une certaine manière de leur lucidité sur les résultats du programme QLIF.
Le financement et les autres appuis
Une transparence... quelque peu opaque...
La méta-analyse est essentiellement un exercice sur la littérature. Celle de Smith-Spangler et al., de 2012, avait été réalisée sans financement, une bourse d'étude mise à part [38]. Ce n'est pas le cas de la méta-analyse examinée ici qui aurait coûté la bagatelle de 316.000 euros [59].
Leifert et al. annoncent clairement deux sources de financement, ce qui se démarque du célèbre auteur d'une étude dépubliée puis republiée sur des rats... L'Union européenne aurait donc apporté sa contribution dans le cadre du projet QLIF (rappel : il s'est terminé en avril 2009...). Le complément – ainsi qu'un soutien technique – a été apporté par le Sheepdrove Trust, selon une phrase bizarrement rédigée. En effet, le Sheepdrove Trust est aussi remercié pour les « "méta-analyses de données sur la composition d'aliments bio et conventionnels" » (les guillemets internes sont des auteurs) [1].
Le Sheepdrove Trust :
« ...appuie les initiatives qui augmentent la durabilité, la biodiversité et l'agriculture biologique, par exemple la recherche en matière de production des semences et de nutrition. Le Trust appuie également des travaux particuliers dans le domaine de la recherche en éducation et l'accompagnement spirituel des vivants et des mourants. » [60]
Une étrange association d'objectifs qui n'est pas sans susciter une comparaison avec une controverse qui a permis à un illustre chercheur français de se dépeindre en victime d'un acharnement médiatique...
Quoi qu'il en soit, les auteurs affirment que le Trust a fourni les fonds sans conditions et qu'il n'a exercé aucune influence sur la conception et la gestion du projet de recherche, ni sur la rédaction de publications à partir des résultats [1].
M. Leifert a répondu à des critiques, y compris sur le financement [61]. Une réponse qui ne peut que nous laisser sceptiques...
...une contribution de la Soil Association...
Les premiers remerciements sont toutefois allés à Lord Peter Melchett, directeur des politiques de la Soil Association, déjà rencontré dans la première partie. M. Melchett avait été invité à faire un examen critique du manuscrit pour s'assurer que les auteurs avaient couvert toutes les informations et publications à la disposition du « principal organe du secteur de l'agriculture biologique au Royaume-Uni », et pour obtenir un retour d'information sur les principaux résultats et conclusions de l'article. M. Melchett n'aurait pas proposé de modifications importantes du manuscrit.
On peut légitimement s'étonner...
...alors, les auteurs sont-ils « indépendants » ?
Mme Marion Nestle, professeur de nutrition, d'études alimentaires et de santé publique à l'Université de New York – qu'on ne peut certainement pas suspecter de connivence avec l'industrie (elle affirme manger bio) – a écrit à propos de la non-ingérence alléguée du Sheepdrove Trust :
« ...c'est exactement le cas des études financées par, disons, Coca Cola. C'est une coïncidence extraordinaire que les résultats des études sponsorisées concluent presque invariablement dans le sens des intérêts des sponsors. Et c'est vrai des résultats que j'aime comme de ceux que je n'aime pas. » [62].
Chacun se fera son opinion !
Une recherche sous le lampadaire ?
Limitation pratique ou choix ?...
Par définition, une méta-analyse ne peut qu'exploiter le fond documentaire existant ; elle est circonscrite au domaine qui a été éclairé par les recherches précédentes. Il n'est donc pas étonnant que les auteurs se soient penchés sur les antioxydants et les pesticides : ce sont des thèmes qui ont été labourés dans tous les sens par la recherche – en partie intéressée – sur l'agriculture biologique. Sur et pour : dans les deux cas, le sens commun suggérait, d'une part que l'on trouvât des différences et, d'autre part, que ces différences fussent en faveur de l'agriculture biologique.
A-t-on dès lors cherché sous le lampadaire par obligation – la partie peu éclairée n'apportant pas assez de données – ou par choix – avec l'objectif de présenter l'agriculture biologique sous un éclairage favorable ?
Chacun se fera son opinion !
...mais un titre et un résumé biaisés...
Il se trouve que la publication présente surtout les aspects favorables à l'agriculture biologique et adopte la perspective de celui qui veut démontrer sa supériorité. Le titre en témoigne.
Mais la publication contient bien plus d'informations – confortées par les informations complémentaires [58] – que ne le laissent entendre le titre et le résumé. Tel est le cas pour les minéraux autres que le cadmium, qui font l'objet d'un paragraphe à la limite du compréhensible.
...et un voile pudique jeté sur certaines différences...
Les auteurs pouvaient difficilement balayer certaines informations essentielles sous le tapis des informations complémentaires. Il en est ainsi pour les teneurs en protéines et acides aminés, et en fibres. Elles sont à l'avantage de l'agriculture conventionnelle ainsi qu'il ressort de la figure 3.
Mais ces différences sont insuffisamment mises en valeur dans le texte.
...alors, l'étude est-elle objective ?
Chacun se fera son opinion.
Mais on trouve ici un problème récurrent des études sur des sujets controversés auxquels l'opinion publique est sensible : elles n'apportent pas seulement une information scientifique (qu'il reste à évaluer), mais sont aussi rédigées de manière à servir de base pour une action médiatique. Il suffit du reste de comparer les titres des articles : laudateurs de l'agriculture biologique dans les cas Benbrook et al. et Leifert et al. (mais pas Heaton), neutres dans les autres.
Une analyse a priori fiable...
Une méthodologie bien expliquée...
Il est indéniable que les auteurs ont soigneusement expliqué leur méthodologie ainsi que les raisons de leurs choix.
L'ensemble du matériau de base est aussi décrit dans les informations complémentaires. Cela contraste du reste avec un autre chercheur bien connu qui a prétendu que ses données de base étaient trop volumineuses pour être publiées...
...et des résultats a priori honnêtement présentés
Il n'y a aucune raison a priori de douter des résultats présentés. En tout cas, aucun commentateur scientifique n'a fait état d'erreurs ou, plus grave, de fraudes sur les calculs et les chiffres.
Le tableau 1 est particulièrement intéressant. Il présente leur jugement global pour 36 paramètres (en partie liés) en termes d'importance de l'effet mesuré, d'incohérence (de dispersion) des données, de précision des données, de biais de publication et de fiabilité globale.
Pour l'activité antioxydante – que l'on peut considérer comme représentative de la première affirmation du titre – ils rapportent un effet modéré, une incohérence (donc une cohérence) moyenne des données, une précision faible, une absence de biais de publication et une fiabilité globale moyenne.
Pour le cadmium, c'est : un effet modéré, une incohérence moyenne des données, une précision moyenne, un biais de publication moyen et une fiabilité globale moyenne
La fiabilité n'est jugée bonne que pour trois paramètres, le TEAC (Trolox Equivalent Antioxidant Capacity) pour un effet faible et les flavones et flavonols, et les flavonols considérés isolément, pour un effet important.
Elle est moyenne pour 19 paramètres et faible pour 14.
Cette évaluation pose inévitablement la question du ton général de l'article et, surtout, de son exploitation médiatique a f: liabilité globale des résultats n'est pas à la hauteur des affirmations péremptoires.
...mais avec un défaut majeur : la largesse pour le matériau de base...
Les auteurs se félicitent en quelque sorte d'avoir réalisé leur méta-analyse sur la base de 343 publications peer-reviewed (alors que Dangour et al. n'avaient retenu que 55 études pour onze paramètres). Certaines publications ayant été présentées au 3e Congrès QLIF, en mars 2007 à Hohenheim (Allemagne), on se permettra d'émettre un doute sur le peer reviewed. Mais c'est somme toute un détail.
La communication à ce sujet ayant été quelque peu floue, il faut aussi préciser que les différents paramètres ont été examinés sur la base d'un sous-ensemble de ces publications. Dans le cas des pesticides, c'est ainsi dix publications selon la description de la méthodologie, onze selon le texte de l'article (nous n'en avons repéré que neuf dans les informations complémentaires).
Mais le problème le plus important est que la décision de retenir un grand nombre de publications est une tare pour la méta-analyse car, forcément, on retient aussi des publications de valeur douteuse, voire franchement mauvaise pour les besoins de la méta-analyse. Selon le mode opératoire décrit par les auteurs, ils n'ont finalement exclu que les études qui ne fournissaient pas de données comparatives sur les deux modes de production, dont les données n'étaient pas exploitables, ou dont les données doublonnaient avec celles d'autres études.
« Comparison of the Nutritive Quality of Tomato Fruits from Organic and Conventional Production in Poland », de Hallmann et Rembiałkowska [63] nous fournit un exemple simple. Il s'agissait d'une comparaison entre deux fermes. Mais elles étaient distantes de 60 km et l'une était sur un sol léger, limono-sableux, et l'autre sur un sol lourd, argileux. Qu'a-t-on dès lors comparé ? L'influence des modes de production, ou du sol ? Et la fertilisation était-elle équivalente ?
Les auteurs ont aussi donné, dans les informations complémentaires, la liste des espèces cultivées entrant dans la méta-analyse. Quelle a été la contribution aux résultats finaux de, par exemple, l'acerola, l'ail, le basilic, le houblon, la marjolaine, la noix de coco, le persil, la roquette, la sarriette, etc. ?
Le problème inverse est de savoir si toutes les publications pertinentes ont été prises en compte. Pour cela, il faudrait faire une recherche bibliographique.
...et avec un autre défaut majeur : l'étroitesse du matériau de base...
Cela peut paraître contradictoire !
Le problème est particulièrement bien illustré par le cas du cadmium. Les auteurs ont trouvé une concentration – de « cadmium toxique » selon le résumé – en moyenne inférieure de 48 % dans les aliments bio. C'est a priori très surprenant.
Le cadmium provient du sol, éventuellement de la pollution, des boues d'épuration, des effluents d'élevage et principalement des engrais phosphatés. Les boues sont interdites en agriculture biologique, et, en matière d'engrais phosphatés, celle-ci ne peut que recourir aux phosphates naturels ; lesquels sont souvent riches en cadmium, contrairement aux phosphates traités et purifiés. La dynamique du cadmium dans les sols et les plantes n'est pas entièrement connue [64]. Mais on s'attend à ce qu'il n'y ait pas de grandes différences entre les deux modes de culture. C'est ce que tend à montrer, par exemple, un document de la Direction générale de l'alimentation (DGAL) [65].
Pourquoi, alors, cette différence dans les résultats ? La méta-analyse a laissé de côté un important fond documentaire en ne retenant essentiellement que les articles publiés dans des journaux à comité de lecture. Et les quelques études retenues ne sont probablement pas représentatives de la réalité des deux modes de production. En particulier, lorsque l'on compare conventionnel et bio, va-t-on apporter des phosphates naturels au segment bio ? Improbable.
Il semble aussi que cette différence de -48 % soit le fruit d'une différence positive, défavorable au bio, pour les légumes et d'une différence négative bien plus grande pour les céréales. En d'autres termes, changez le mix de cultures et vous obtenez un résultat différent.
...et les pesticides, quel intérêt ?
Quel intérêt y avait-il à éplucher une littérature scientifique bien maigre – dix ou onze publications selon l'article, dont neuf déjà utilisées par Smith-Spangler et al. – pour conclure, en résumé, que « la fréquence de la présence de résidus de pesticides a été quatre fois supérieure dans les cultures conventionnelles » ?
Les auteurs ont donc fourni une information binaire (présence ou absence de résidus), sans aucun détail sur la nature des pesticides, ni sur les teneurs en cause. Pour ces dernières, les auteurs précisent que les publications ne permettent pas de comparaisons robustes. Pourquoi alors avoir communiqué sur les pesticides ? Par ailleurs, ils n'ont pas obtenu de données sur les céréales, les oléagineux et les légumineuses.
En outre, mais ce n'est pas dit, les recherches de pesticides se font quasi exclusivement sur ceux qui sont utilisés en agriculture conventionnelle. Il y a donc un biais qu'il est impossible d'évaluer (du reste, les données compilées par l'EFSA souffrent du même biais).
S'il fallait trouver un intérêt à ce segment de la méta-analyse, ce serait pour souligner que, mesurée à l'aune des fréquences de résidus, la performance de l'agriculture biologique est bien décevante !
Des conclusions hasardeuses sinon injustifiées
Le canal scientifique et le canal médiatique
« Beaucoup de ces composés [antioxydants] ont été liés à des risques réduits de maladies chroniques, y compris les maladies cardiovasculaires et les maladies neurodégénératives et certains cancers, dans des études sur les interventions dans la diététique et épidémiologiques. » [1]
Cette affirmation du résumé est exacte. Mais, dans son contexte, c'est une subtile suggestion de supériorité nutritionnelle et de santé des produits de l'agriculture biologique. L'énumération d'affections médiatiquement « à la mode » est très significative... Et la phrase suivante traite des pesticides et du « cadmium toxique », en s'ouvrant par « en outre » (« additionally »).
On pourra rétorquer que l'article se termine par des considérations sur la nécessité de développer des protocoles standardisés pour les études comparatives de composition des aliments ; qu'il souligne l'existence de lacunes dans une grande partie des études publiées ; que, se référant à Smith-Spangler et al. :
« ...il y a un besoin urgent d'études bien contrôlées d'interventions humaines dans les régimes alimentaires ou de cohortes pour identifier/quantifier les incidences potentielles sur la santé humaine de la consommation de produits biologiques par rapport aux conventionnels. »
Il se trouve tout simplement que le résumé, souvent le seul lu par les faiseurs d'opinion (si tant est qu'ils lisent), n'en fait pas état.
Des interprétations tendencieuses
En résumé, les auteurs ont trouvé des teneurs plus élevées en acides phénoliques (19 %), flavanones (69 %), stilbènes (28 %), flavones (26 %), flavonols (50 %) et anthocyanines (51 %). Mais c'est avec une fiabilité globale moyenne, sauf pour les flavonols.
Mais ce n'est qu'une partie du problème !
Les auteurs ont noté, entre autres, que les taux de protéines étaient moindres en agriculture biologique. Davantage d'antioxydants vaut-il la perte en protéines sur le plan nutritionnel ?
Les auteurs « expliquent », en se fondant curieusement sur d'autres études plutôt que leurs propres chiffres :
« La signification/pertinence nutritionnelle des concentrations légèrement moindres en protéines et acides aminés dans les cultures bio pour la santé humaine est vraisemblablement faible, les régimes européens et nord-américains fournissant typiquement assez ou même trop de protéines et d'acides aminés essentiels. De plus, alors que quelques études concluent que la teneur en protéines des régimes alimentaires européens et nord-américains est trop élevée et que cela contribue à l'incidence croissante du diabète et de l'obésité, d'autres études ont rapporté qu'augmenter la consommation de protéines peut être une stratégie pour prévenir l'obésité. C'est pourquoi les concentrations moins élevées en protéines et en acides aminés trouvées dans les aliments bio n'ont probablement pas d'impact significatif sur la nutrition et la santé. »
Curieusement ? Peut-être pas ! Les auteurs ont – curieusement ? – omis de chiffrer la perte en protéines
Des « concentrations légèrement moindres » ? La diminution est « forte » selon leur tableau 1 (sauf erreur de 15 %).
Leurs considérations plutôt confuses témoignent de leur gêne. Et d'un biais ! Et quand on sait que beaucoup de végétariens mangent bio, en ayant du mal à trouver les protéines nécessaires, elles posent la question de leur pertinence...
Une étude hémiopique
Par ailleurs, la méta-analyse n'aborde pas d'autres questions pertinentes, en particulier celle de la présence de métabolites de la plante (alcaloïdes...) ou de micro-organismes (mycotoxines...) connus pour leur effet négatif sur la santé. D'autres auteurs se sont penchés sur l'ensemble de la question, y compris dans des études de la littérature. Une conclusion [66] :
« ...il devient difficile de justifier des allégations générales dans le sens d'une plus-value des légumes et des pommes de terre bio par rapport au conventionnel. »
Un bénéfice pour les antioxydants ?
Y a-t-il un avantage nutritionnel et de santé dans un régime qui serait plus riche en antioxydants – statistiquement car, évidemment, personne ne peut contrôler les teneurs des produits achetés en faisant ses courses ? On peut, au minimum, se montrer sceptique.
Et retourner l'argument déployé pour les protéines : quel intérêt si les régimes sont déjà saturés ?
Le Pr Tom Sanders, chef de la division du diabète et des sciences de la nutrition, École de médecine, King's College de Londres, souligne en particulier l'insuffisance des connaissances en la matière, dans un commentaire sur la méta-analyse [67]. Si on a conclu à un lien entre consommation de fruits et légumes et diminution des risques de cancer, les données manquent pour le rôle des antioxydants et des composés phénoliques ; et les polyphénols inhibent l'absorption des métaux et sont considérés comme antinutritionnels.
De surcroît, les dernières recherchent suggèrent que les antioxydants ne préviennent pas le cancer mais peuvent au contraire l'accélérer [68].
Un bénéfice pour le cadmium ?
Les auteurs ont trouvé une concentration de cadmium – de « cadmium toxique » selon le résumé –en moyenne inférieure de 48 % dans les aliments bio. Mais ils notent dans le texte qu'il est difficile d'estimer les bénéfices exacts d'une réduction de l'absorption du cadmium via la consommation de produits bio.
En fait, l'exposition au cadmium à travers l'alimentation est généralement faible et ne pose pas de problème de santé, l'EFSA étant cependant moins catégorique que les instances états-uniennes [69].
Les auteurs ont fait l'effort louable d'avancer une série de considérations sur les différences de teneur en cadmium. Ils concluent, à juste titre, qu'il faudrait davantage d'études pour mieux comprendre les facteurs agronomiques, pédo-climatiques et génétiques sous-tendant les différences.
Mais c'est implicitement reconnaître que la différence mesurée n'est, au mieux, que partiellement due au mode de production. On peut dès lors aussi considérer que le titre de l'article – exact s'agissant des résultats bruts – manque de retenue s'agissant des résultats interprétés à l'aune des connaissances actuelles.
Un bénéfice pour les pesticides ?
La méta-analyse se réduit à une analyse binaire sur la présence ou l'absence de résidus de pesticides autorisés dans le mode de culture conventionnel, à l'exclusion donc des pesticides autorisés dans le mode biologique, et ce, sur la base d'un nombre très limité d'études publiées dans des revues scientifiques.
Autorisés en agriculture biologique ? Ou utilisés sans autorisation. Il est notoire que certains produits ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché en tant que produit phytosanitaire sont vendus en France à d'autres fins théoriques [70]. Que certains produits « naturels » sont connus pour être dangereux ; la roténone, par exemple, est impliquée dans la maladie de Parkinson ; le neem est un perturbateur endocrinien. La France vient d'autoriser provisoirement un produit à base d'azadirachtine (le composant principal de l'huile de neem) sur pommier avec des conditions d'emploi drastiques et un délai avant récolte (DAR) de... 42 jours [71]. Les résidus de tels produits sont rarement recherchés.
La méta-analyse n'apporte rien de neuf ; si ce n'est une démonstration de la capacité de certains chercheurs à s'enfermer dans leur tour d'ivoire en se concentrant sur les publications de leur sérail et en négligeant l'extraordinaire fond documentaire que constituent notamment les contrôles de résidus de pesticides effectués par les services officiels.
Trouver un avantage de santé à consommer bio, c'est aussi prétendre que les autorités responsables de la santé – dans le monde entier – sont au mieux négligentes, au pire complices d'une atteinte à la santé des populations. Il est temps que cette paranoïa cesse, sauf, évidemment, à documenter les atteintes.
LA COMMUNICATION
La propagande à la mode Leifert
Pourquoi s'être penché si longuement sur une méta-analyse qui, au final, n'apporte pas grand chose ? C'est que, comme beaucoup d'œuvres de la science – la vraie ou la parallèle – portant sur des thèmes qui agitent la société, elle a fait l'objet d'un tapage médiatique. Un tapage organisé par l'auteur principal lui-même [72].
Cela se passe (presque) de commentaires :
« Dans une récente étude, une équipe internationale d'experts dirigée par l'Université de Newcastle au Royaume-Uni a prouvé que les cultures et les aliments à base de plantes cultivées en Agriculture Biologique (AB) contiennent jusqu'à 60 % de plus d’antioxydants clés que ceux produits en agriculture conventionnelle.
Une analyse de 343 études sur les différences de composition entre les cultures biologiques et conventionnelles a permis aux chercheurs de constater que le passage à une consommation de fruits, légumes et céréales bio, et d'aliments à base de ces produits, pourraient fournir un complément en antioxydants équivalent à une consommation supplémentaire de 1 à 2 portions de fruits et légumes par jour. »
Les communicants institutionnels n'ont pas résisté à la tentation de citer un gros chiffre (ce n'est cependant pas le plus élevé). Ni à celle de donner une dimension nutritionnelle et de santé à l'étude.
Ils sont pourtant restés mesurés. Dans une étude précédente à laquelle M. Leifert avait participé, les auteurs avaient osé estimer l'augmentation de l'espérance de vie issue de l'adoption d'une alimentation bio ; ils avaient postulé pour ce faire qu'une augmentation de 12 % de la teneur en composés biologiquement actifs dans le bio – bien modeste par rapport aux 60 % revendiqués pour la méta-analyse, certes pour les seuls antioxydants – était équivalente à une augmentation de 12 % de la consommation de fruits et légumes. Résultat : 17 jours pour les femmes, 25 jours pour les hommes [73] !
Aujourd'hui, M. Leifert conclut prudemment sur la nécessité d'études nutritionnelles. Comme on l'a vu, il s'agit de la reprise de l'opinion de Smith-Spangler et al., formulée en 2012. Il se trouve qu'une étude de cohorte de... 623.080 femmes britanniques suivies sur 9,3 années a été publiée fin avril 2014. Résultat :
« Dans cette grande étude prospective, il y a eu peu ou pas de diminution de l'incidence des cancers associée à la consommation de produits bio, excepté peut-être pour le lymphome non hodgkinien. » [74]
Cette étude n'est pas citée. Peut-on penser qu'elle était trop récente pour être prise en compte ? Toujours est-il que toute prudence est abandonnée dans le communiqué de presse s'agissant de la comparaison entre les deux modes de production :
« Le débat sur la comparaison entre AB et agriculture conventionnelle a grondé pendant des décennies maintenant, mais les données de cette étude montrent sans équivoque que les aliments issus de l'AB sont plus riches en antioxydants et moins contaminés par des métaux toxiques et des pesticides. »
« [S]ans équivoque » ? Quel mensonge à la lumière de l'appréciation des auteurs eux-mêmes sur la fiabilité globale de leurs résultats !
La prudence était du reste déjà perdue sur la question nutritionnelle. Mangez bio ! Propos également de M. Leifert :
« [L'étude]porte aux consommateurs de nouvelles informations importantes par rapport à celles disponibles jusqu'à présent qui étaient contradictoires dans de nombreux cas et ont été souvent source de confusion. »
Les médias critiques...
L'annonce tonitruante a été suivie au Royaume-Uni et aux États-Unis d'Amérique, comme il se doit, par la collecte des avis de spécialistes. Le Science Media Center en a publié quatre le jour même [67], ainsi qu'une appréciation générale [75].
Les médias et de nombreux bloggueurs de ces deux pays ont publié des articles nuancés, présentant les avis des uns et des autres, certains s'étant fait fort critiques des conclusions de M. Leifert. Le Guardian – tendance très verte – titre : « Clear differences between organic and non-organic food, study finds » (une étude trouve des différences nettes entre les produits bio et conventionnels), mais cite un critique et fait état de certaines limitations [76]. Le Telegraph est bien plus tranché : « New study to split opinion on organic food » (une nouvelle étude divisera les opinions sur les produits bio) [77]. Quant à la BBC, « Study sparks organic foods debate » (une étude lance la polémique sur les produits bio ») plante le décor dès les premiers paragraphes [78].
Parmi les blogs, Geneticliteracyproject a été le plus direct : l'étude prétendant que les produits bio sont plus nutritifs est bourrée de défauts [79].
...et les médias paresseux
Et dans la France frappée de léthargie estivale ? L'esprit critique – la déontologie journalistique pour tout dire – a été aux abonnés absents. Même au Figaro généralement critique sur ce genre de sujets [80]...
Le Monde [81] et le Figaro ? C'était publié le 22 et le 29 juillet 2014, soit 11 et 18 jours après les communiqués initiaux. Et ils n'ont pas eu la présence d'esprit de vérifier ce qu'on pensait de la méta-analyse...
Mais on finira par une grave question : qu'y a-t-il de plus choquant, le billet de Générations futures, la petite entreprise de M. François Veillerette, qui trouve que « l’alimentation biologique [...] ne contient pas de résidus de pesticides » – alors que la méta-analyse en trouve justement, mais quatre fois moins en fréquence [82] – ou le Quotidien du médecin, dont l'effort intellectuel a été nul (voir aussi les commentaires) [83].
La meilleure nouvelle, c'est peut-être encore que, la France étant en vacances, la très modeste contribution à l'avancement des connaissances que constitue la méta-analyse de Leifert et al. n'ait reçu qu'une modeste attention.
LA SCIENCE ET LA POLITIQUE INTERPELLÉES
Ausser Spesen nichts gewesen (1) ?
Superbe formule germanique : des dépenses, sinon rien.
La méta-analyse de Leifert et al. comporte trois volets :
- Sur le volet de la composition nutritionnelle des aliments, elle n'apporte rien au paysage scientifique que l'on ne sache déjà : la composition des aliments varie en fonction des méthodes de culture et on peut dégager certaines tendances différenciant les modes biologique et conventionnel, sans qu'il soit possible d'en déduire dans tous les cas des effets nutritionnels et de santé ; et sachant – ce que la méta-analyse omet de préciser – que les modes de production varient considérablement et se chevauchent d'une manière générale (le bio intensif n'a plus les vertus prêtées à une agriculture biologique idéalisée) ou sur un facteur de production pertinent (l'irrigation, par exemple).
- Sur le volet des pesticides, elle enfonce une porte ouverte : ce serait péché si la fréquence de détection de résidus de produits phytosanitaires autorisés en mode conventionnel n'était pas moindre sur les produits de l'agriculture biologique. Mais elle s'abstient de conclure : la performance de l'agriculture biologique n'est pas à la hauteur des attentes.
- Sur le volet du cadmium, elle produit une affirmation au mieux douteuse... et tend à démontrer la faiblesse méthodologique de la méta-analyse.
Tout ça, donc, pour 316.000 euros [59] dont une partie – combien ? – de fonds publics communautaires.
Much ado about nothing ?
Alors, beaucoup de bruit pour rien ? Ce serait une erreur de le croire.
La méta-analyse – et surtout la communication orchestrée par M. Leifert et l'Université de Newcastle – a fait du bruit médiatique, certes temporaire, mais ayant laissé des scories dans la médiasphère et surtout le cyberespace. Elles remonteront à la surface pendant des années.
Cette permanence de – osons le qualificatif – la désinformation est renforcée par le fait que la méta-analyse s'inscrit dans une polémique britannique périodiquement ressuscitée. Cette situation résulte en grande partie de la chronologie des événements, mais on peut se demander s'il n'y a pas eu une intention de détourner le projet QLIF pour alimenter la controverse entre la Soil Association et la Food Standards Agency.
Sur le plan scientifique, la méta-analyse est appelée à un grand succès, bien qu'on puisse la ranger aux frontières de la science parallèle, et en tout cas dans la catégorie de l'alterscience à objectif politique. Qui pourra, à l'avenir, produire une étude sur un aspect particulier de la question de la qualité nutritionnelle des aliments sans la citer ? Et sans se positionner par rapport à elle ? Cela se fera souvent au détriment d'études plus sérieuses.
Dans quelque temps se déploieront aussi les manœuvres politiques, sinon politiciennes, aux objectifs louables ou inavouables. Elles seront facilitées par le label « UE » que confère l'inscription posthume de la méta-analyse dans le projet QLIF.
Ausser Spesen nichts gewesen (2) ?
La méta-analyse pose en dernière analyse la question plus fondamentale de l'utilisation des fonds publics européens. L'Union européenne a mis 12,4 millions d'euros dans un projet dont la production scientifique a été très faible et peu originale, et aussi partiale. C'est l'avis de MM. Léon Guéguen et Gérard Pascal, auteurs de « Le point sur la valeur nutritionnelle et sanitaire des aliments issus de l’agriculture biologique », une mise à jour de l'étude de l'AFSSA de 2003, s'agissant de la valeur nutritionnelle des aliments [84]. En fait ce n'est guère mieux pour les autres domaines.
Cette production a aussi alimenté cinq congrès, dont trois organisés en parallèle avec des événements dédiés à l'agriculture biologique. En définitive, le projet QLIF a été une subvention déguisée à la promotion d'une filière agricole. Et plus particulièrement à un club de chercheurs et d'institutions de recherche œuvrant à l'appui de cette filière.
La méta-analyse Leifert et al. en est la dernière manifestation.
Wackes Seppi
_______________
[1] Marcin Baranski, Dominika Srednicka-Tober, Nikolaos Volakakis, Chris Seal, Roy Sanderson,
Gavin B. Stewart, Charles Benbrook, Bruno Biavati, Emilia Markellou, Charilaos Giotis, Joanna Gromadzka-Ostrowska, Ewa Rembiałkowska, Krystyna Skwarło-Sonta, Raija Tahvonen, Dagmar Janovska, Urs Niggli, Philippe Nicot, Carlo Leifert
http://csanr.wsu.edu/m2m/papers/organic_meta_analysis/bjn_2014_full_paper.pdf
[2] http://old.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991R2092:FR:HTML
[3] http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/32007r0834_internet_cle8a2897.pdf
[4] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006R1924&from=FR
[5] http://agriculture.gouv.fr/l-agriculture-biologique
[6] http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/040214-ProgrammeBio-BD_cle0ad8d8.pdf
[7] http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/european-action-plan/2004/index_en.htm
Avec liens.
[8] http://www.qlif.org/
[9] Voir par exemple sur ce site :
http://www.imposteurs.org/article-agriculture-biologique-un-fibl-bien-faible-par-wackes-seppi-96151754.html
[10] http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1541-4337.2010.00108.x/full
[11] http://en.wikipedia.org/wiki/Meta-analysis
[12] http://www.soilassociation.org/LinkClick.aspx?fileticket=cY8kfP3Q%2BgA%3D&
[13] http://www.theguardian.com/uk/2001/aug/07/research.medicalscience
[14] http://www.sirc.org/articles/double_standards.shtml
[15] https://www.anses.fr/sites/default/files/documents/NUT-Ra-AgriBio.pdf
[16] http://www.charlatans.info/bio.shtml
[17] http://orgprints.org/15494/1/38-Lairon.pdf
Que penser de cette déclaration, sinon que M. Lairon évolue aux frontières de la science :
« Le développement annoncé de l’AB est une opportunité unique à saisir pour développer la recherche participative et multidisciplinaire, de l’amont à l’aval de la filière. Une exemple remarquable en est le projet intégré européen Quality Low Input food (QLIF, 2004-08), associant 30 laboratoires et destiné à développer une telle approche multidisciplinaire pour optimiser les systèmes de production alimentaire biologiques et à faible niveau d'intrants (www.qlif.org). Le fait que l’agriculture biologique puisse notablement contribuer à la sécurité alimentaire mondiale a été récemment reconnu par la FAO, qui a de ce fait proposé des recommandations pour la recherche et le développement (El-Hage Scialabba, 2007). »
Le document cité, émanant d'une fonctionnaire, ne contient en aucun cas des recommandations de la FAO.
[18] Par exemple :
http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/7067100.stm
http://www.theguardian.com/science/2007/oct/29/organics.sciencenews
http://www.dailymail.co.uk/news/article-490255/Organic-food-really-IS-better-claims-study.html
http://www.organicpathways.co.nz/household/story/608.html
[19] http://www.qlif.org/Library/leaflets/folder_0_small.pdf
La date est donnée, verticalement, dans la marge de droite sur la dernière page.
[20] http://www.organic-world.net/news-organic-world.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=43&cHash=cf9082e9b504c9fedee4124aa7b261fe
[21] http://angrymoms.org/pdf/better_organic.pdf
[22] http://cordis.europa.eu/news/rcn/28607_en.html
[23] http://returntofood.com/2007/11/20/funding-the-bloody-obvious-organic-is-superior/
[24] Charles Benbrook, Xin Zhao, Jaime Yáñez, Neal Davies, Preston Andrews
http://organic-center.org/reportfiles/Nutrient_Content_SSR_Executive_Summary_2008.pdf
http://organic-center.org/reportfiles/NutrientContentReport.pdf
Tableaux synthétiques :
http://organic-center.org/reportfiles/Nutrient%20Density_Matched_Pairs_Supplemental_Info.pdf
[25] Organic Food Study Is Flawed, Conclusions Unsupported by Science
http://news.heartland.org/newspaper-article/2008/11/01/organic-food-study-flawed-conclusions-unsupported-science
[26] Claims of Organic Food’s Nutritional Superiority: A Critical Review
https://secure.martinsolutions.com/~opca/pdfs/insight/organics/20080723_claimsoforganic.pdf
[27] Alan D Dangour, Sakhi K Dodhia, Arabella Hayter, Elizabeth Allen, Karen Lock, and Ricardo Uauy, Nutritional quality of organic foods: a systematic review,
http://ajcn.nutrition.org/content/early/2009/07/29/ajcn.2009.28041.abstract?maxtoshow=&HITS=10&hits=10&RESULTFORMAT=&fulltext=organic&searchid=1&FIRSTINDEX=0&sortspec=relevance&resourcetype=HWCIT
[28] http://multimedia.food.gov.uk/multimedia/pdfs/organicreviewappendices.pdf
[29] http://www.independent.co.uk/life-style/food-and-drink/news/organic-food-debate-boils-over-1767911.html
[30] http://www.slate.com/articles/health_and_science/green_room/2009/08/are_organic_veggies_better_for_you.html
[31] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2897221/
[32] https://www7.inra.fr/comite_agriculture_biologique/media/accueil/actualites/communique_denis_lairon_qualite_des_produits_bio
[33] Charles Benbrook, Donald R Davis, Preston K Andrews, Methodologic flaws in selecting studies and comparing nutrient concentrations led Dangour et al to miss the emerging forest amid the trees
http://ajcn.nutrition.org/content/90/6/1700.full
[34] Nutrient content not a primary issue in choosing to buy organic foods
http://ajcn.nutrition.org/content/90/6/1699.full
[35] Alan D Dangour, Elizabeth Allen, Karen Lock, and Ricardo Uauy, Reply to DL Gibbon and C Benbrook et al.
http://ajcn.nutrition.org/content/90/6/1701.full
[36] Alan D Dangour, Sakhi K Dodhia, Arabella Hayter, Elizabeth Allen, Karen Lock, Ricardo Uauy
http://ajcn.nutrition.org/content/92/1/203.long
[37] http://multimedia.food.gov.uk/multimedia/pdfs/organicreviewreport.pdf
[38] Crystal Smith-Spangler, Margaret L. Brandeau, Grace E. Hunter, J. Clay Bavinger, Maren Pearson, Paul J. Eschbach, Vandana Sundaram, Hau Liu, Patricia Schirmer, Christopher Stave, Ingram Olkin, Dena M. Bravata
http://annals.org/article.aspx?articleid=1355685
http://media.dssimon.com/taperequest/acp75_study.pdf
[39] Initial Reflections on the Annals of Internal Medicine Paper “Are Organic Foods Safer and Healthier Than Conventional Alternatives? A Systematic Review”
http://www.tfrec.wsu.edu/pdfs/P2566.pdf
[40] http://www.motherjones.com/tom-philpott/2012/09/five-ways-stanford-study-underestimates-organic-food
[41] http://www.organicnewsroom.com/2012/09/stanford_research_confirms_hea.html
[42] http://www.strategie.gouv.fr/blog/wp-content/uploads/2013/10/rapport-INRA-pour-CGSP-VOLUME-1-web07102013.pdf
[43] Tempête à l’INRA autour d’un rapport sur l’agriculture biologique
http://www.reporterre.net/spip.php?article5402
Reporterre publie en exclusivité la liste des 126 scientifiques critiquant le Rapport INRA sur l’agriculture biologique
http://www.reporterre.net/spip.php?article5467
Rapport INRA : voilà comment il a été saboté par les partisans de l’agriculture productiviste
http://www.reporterre.net/spip.php?article5466
[44] Le rapport partial de l’INRA sur l’agriculture bio : les politiques s’en mêlent
http://www.reporterre.net/spip.php?article5428
[45] http://cordis.europa.eu/result/rcn/51626_en.html
[46] http://www.tubitak-food2009.org/
Les documents issus du programme QLIF sont en principe versés à Organic Eprints. Le FiBL tient une archive des documents revus par les pairs :
http://www.fibl.org/de/themen/lebensmittelqualitaet-sicherheit/fibl-projekte/qlif/qlifpeerreviewedpapers.html#c5553
[47] http://www.ncl.ac.uk/energy/people/profile/carlo.leifert
[48] http://www.nefg-organic.org/ecological-farming/
[49] http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1354787/Prince-Charles-helps-Tesco-in-organic-food-venture.html
[50] http://www.ensser.org/fileadmin/user_upload/French_ENSSER_Statement_no_scientific_consensus_on_GMO_safety_LV.pdf
http://www.ensser.org/media/0713/
http://www.ensser.org/fileadmin/user_upload/First_signatories_to_the_statement_no_scientific_consensus_on_GMO_safety_131022.pdf
Comme quoi on peut être, par exemple, géographe ou astronome à la retraite et se considérer comme un des « scientifiques, médecins, académiciens et experts des disciplines relevant des aspects liés à l’évaluations [sic] scientifique, légale, sociale et sanitaire des organismes génétiquement modifiés (OGM) ».
[51] http://www.endsciencecensorship.org/en/page/Statement#signed-by
http://www.independentsciencenews.org/health/seralini-and-science-nk603-rat-study-roundup/
[52] http://www.earthopensource.org/files/pdfs/Roundup-and-birth-defects/RoundupandBirthDefectsv5.pdf
[53] http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/agriculture/2012/438-Benbrook-Report-Summary.pdf
[54] http://www.orgprints.org/13379/
[55] http://www.owwz.de/fileadmin/user_upload/POLEN-Seite/Events/Rembialkowska.pdf
[56] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1573521411000054
http://www.researchgate.net/publication/227732962_Quality_of_plant_products_from_organic_agriculture/file/79e41509792513f357.pdf
Voir aussi :
http://cdn.intechopen.com/pdfs-wm/40656.pdf
[57] http://leplus.nouvelobs.com/philippe-nicot
http://www.iobc-wprs.org/people/cv_nicot_philippe.html
[58] http://csanr.wsu.edu/m2m/papers/organic_meta_analysis/bjn_2014_supplemental_data.pdf
[59] http://organic-center.org/uncategorized/newcastle-study-q-a/
[60] http://opencharities.org/charities/328369
[61] https://docs.google.com/document/d/1plRQtM5d9HZGV9OWb0BKGDfUfthUHxp5KjzBmlG6i0w/edit
[62] http://www.foodpolitics.com/2014/07/are-organic-foods-more-nutritious-and-is-this-the-right-question/
[63] http://orgprints.org/9944/1/Hallmann__P_Final_tomato_Hohenheim_2007.pdf
[64]http://www.pleinchamp.com/grandes-cultures/actualites/les-engrais-phosphates-principale-source-d-accumulation-de-cadmium-dans-le-sol
[65] http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/D37-1.pdf
[66] Par exemple : A literature‐based comparison of nutrient and contaminant contents between organic and conventional vegetables and potatoes, Hoefkens, C., Vandekinderen, I., De Meulenaer, B.; Devlieghere, F., Baert, K., Sioen, I., De Henauw, S., Verbeke, W., Van Camp J., British Food Journal, 111 (10), 1078‐1097, 2009.
https://biblio.ugent.be/input/download?func=downloadFile&recordOId=822235&fileOId=906573
[67] http://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-study-comparing-the-nutritional-content-of-organic-and-conventional-foods/
[68] http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcibr1405701
[69] http://www.epa.gov/osw/hazard/wastemin/minimize/factshts/cadmium.pdf
http://extoxnet.orst.edu/faqs/foodcon/cadmium.htm
http://www.efsa.europa.eu/de/efsajournal/doc/980.pdf
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/doc/2551.pdf
[70] https://www.youtube.com/watch?v=VVeowXl1HVo
Il va de soi que M. Romain Juthier a reçu une volée de bois vert pour avoir osé dire et montrer la vérité...
[71] http://e-phy.agriculture.gouv.fr/
Chercher Neemazal-T/S
[72] http://www.ncl.ac.uk/press.office/press.release/item/new-study-finds-significant-differences-between-organic-and-non-organic-food
Version française du FiBL :
http://www.fibl.org/fr/medias/archives-medias/archives-medias14/communique-medias14/article/une-nouvelle-etude-met-en-evidence-des-differences-significatives-en-matiere-de-sante-entre-les.html
[73] Agroecosystem Management and Nutritional Quality of Plant Foods: The Case of Organic Fruits and Vegetables, K. Brandt, C. Leifert, R. Sanderson & C. J. Seal
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07352689.2011.554417#.U-3IMsV_sud
[74] Organic food consumption and the incidence of cancer in a large prospective study of women in the United Kingdom, K E Bradbury, A Balkwill, E A Spencer, A W Roddam, G K Reeves, J Green, T J Key, V Beral, K Pirie and The Million Women Study Collaborators
http://www.nature.com/bjc/journal/v110/n9/full/bjc2014148a.html
[75] http://www.sciencemediacentre.org/nutritional-content-of-organic-and-conventional-foods/
[76] http://www.theguardian.com/environment/2014/jul/11/organic-food-more-antioxidants-study?utm_content=buffer8de23&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
[77] http://www.telegraph.co.uk/health/healthnews/10962499/New-study-to-split-opinion-on-organic-food.html
[78] http://www.bbc.com/news/science-environment-28270803
[79] http://www.geneticliteracyproject.org/2014/07/15/study-claiming-organic-food-more-nutritious-deeply-flawed-say-independent-scientists/
[80] http://sante.lefigaro.fr/actualite/2014/07/29/22639-antioxydants-pesticides-bio-sort-lot
[81] http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/07/22/les-fruits-et-legumes-bio-plus-riches-en-antioxydants_4461076_3244.html
[82] http://www.generations-futures.fr/bio/des-differences-significatives-entre-les-aliments-biologiques-et-non-biologiques/
[83] http://www.lequotidiendumedecin.fr/actualite/sante-publique/le-bio-c-est-meilleur-pour-la-sante-selon-une-revue-de-343-etudes
[84] http://www.com-agri.fr/documents/NutritionDietetique.pdf
Voir aussi la présentation :
http://www.com-agri.fr/documents/LeonGueguen.pdf